
 |
| Grand
Bal d'Hiver 2010 le Samedi 27 Novembre 2010 |
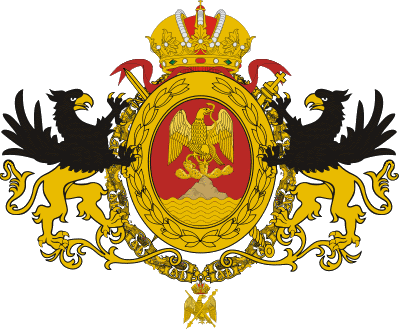 |
Un nouvel état indépendant Le Mexique était au milieu du XIXe siècle
un vaste territoire s'étendant sur plus de deux millions de kilomètres
carrés, habité par plus de 8 millions de personnes. Parmi cette population,
seulement 2,5 millions étaient des descendants des colons espagnols.
|
|
Antonio Lopez de Santa Anna, |
Doña Dolores Tosta de Santa Anna, |
|
En 1846, débute la guerre américano-mexicaine. Le Texas, essentiellement peuplé par l'afflux d'Américains, s'était constitué en république indépendante depuis une révolte générale de sa population en 1836 contre le gouvernement mexicain. La victoire américaine a scellé l'annexion, puis d'autres territoires du nord-ouest vont aussi être revendiqués par le Texas pour être finalement rattachés aux Etats Unis d'Amérique. C'est près de la moitié de son territoire qu'a ainsi perdu le Mexique, en plus de milliers de victimes, quand la guerre se termine en 1848.
|
La guerre de RéformeLe Mexique tente de se reconstruire. En 1857, éclate une guerre civile qui oppose les libéraux à l'Eglise catholique, cette dernière étant très influente dans les affaires de l'Etat. Benito Juarez Garcia, d'origine indigène, accède à la présidence en 1858, mais ne parvient pas à maîtriser la dette extérieure du pays. Une crise politique éclate et divise les classes dirigeantes. De retour au pouvoir en 1861, Juarez suspend les paiements aux créanciers européens de l'Etat mexicain et harcèle les étrangers qui y résident. |
|
Benito Pablo Juárez García Au vu de cette instabilité, Napoléon III décèle l'occasion de mettre en place outre-Atlantique un régime politique qui soit favorable aux intérêts de l'empire français et du catholicisme. Cela éviterait que les Etats-Unis d'Amérique étendent leur mainmise sur l'isthme de Panama ou qu'à la suite de la ruée vers l'or californien ils s'intéressent aux gisements d'argent du nord-ouest du Mexique. L'empereur escompte que grâce à un rapprochement avec ce pays « nous aurons rétabli notre influence bienfaisante au centre de l'Amérique, et cette influence, en créant des débouchés immenses à notre commerce, nous procurera les matières indispensables pour notre industrie ». Le modèle qu'offrirait aux précaires républiques d'Amérique latine une monarchie catholique prospère établie au Mexique les gagnerait bientôt par contagion, créant ainsi un contrepoids à la sphère protestante. Les opposants au régime de Juarez réfugiés en France ont en effet donné à croire au chef de l'Etat que le peuple mexicain abhorre le régime républicain et appelle un souverain de ses vœux. « Il est contraire à mes intérêts, à mon origine et à mes principes d'imposer un gouvernement quelconque au peuple mexicain : qu'il choisisse en toute liberté la forme qui lui convient, je ne lui demande que la sincérité dans ses relations extérieures, je ne désire qu'une chose, c'est le bonheur et l'indépendance de ce beau pays sous un gouvernement stable et régulier. » Encouragé par l'Impératrice Eugénie et le conservateur mexicain José-Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, Napoléon III se détermine en 1861 à mettre en application ce qu'on qualifia de « plus grande pensée du règne ». Les conditions géopolitiques étaient favorables à l'intervention : les américains ne pouvaient s'opposer à une ingérence européenne sur leur continent, car ils étaient alors en pleine guerre de Sécession. L'offensiveNapoléon III pensait, par une pression diplomatique et au besoin militaire, obtenir l'abdication de Benito Juarez pour établir un pouvoir monarchique. Le 31 octobre 1861, par la Convention de Londres, l'Angleterre et l'Espagne se joignent à la France pour imposer à Benito Juarez le remboursement de l'emprunt d'Etat contracté en Europe et garantir les intérêts de leurs ressortissants nationaux au Mexique. |
|
Jean-Pierre Edmond Jurien de la Gravière,
|
Don Joan Prim , marquis de Castillejos, |
|
En janvier 1862, une expédition composée d'un corps anglais, sous le commandement de l'amiral Dunlop, d'un corps français
sous celui de l'amiral Edmond Jurien de la Gravière, et d'un corps espagnol sous celui du général Prim, s'empare de Veracruz
sans rencontrer de résistance.
Inauguration de la ligne transatlantique du Mexique. 14 avril 1862,
Saint-Nazaire Espérant, depuis la fin de la guerre en Italie, regagner la sympathie de l'Autriche, Napoléon III a imaginé de proposer la couronne de l'empire du Mexique à un frère de l'empereur François-Joseph : l'archiduc Maximilien de Habsbourg. Lorsque les alliés anglais et espagnols comprennent le véritable dessein de Napoléon III, ils se retirent de l'offensive.
Veracruz, sortie des chasseurs d'Afrique La France combat seule, mais cela ne la fait pas reculer. La résistance
mexicaine s'est pourtant organisée, et une première tentative
pour s'emparer de la ville forte de Puebla se solde par un échec.
L'année suivante, après un siège de deux mois,
Puebla est prise, le 17 mai 1863, par le général Forey.
Les troupes françaises entrent le 10 juin suivant dans la ville
de Mexico, d'où Benito Juarez avait fui. Une assemblée
de notables vote alors l'abolition de la république et proclame
l'archiduc Maximilien empereur, le 10 juillet 1863.
|
|
Le serment du capitaine Danjou et ses hommes, |
Pendant neuf longues heures, aveuglés par la fumée des incendies, étouffés par la soif, accablés par la chaleur et la faim qui les tenaille, les légionnaires, fauchés un à un par les balles qui sifflent dans la pièce, tiennent en échec une multitude d'adversaires. Les pertes qu'ils leur ont infligées se montent à 90 morts et 300 blessés... Une fois les dernières cartouches tirées, les six survivants encore valides mettent la baïonnette au canon et font une sortie en chargeant toute une armée : " Nous nous rendrons, finissent-ils par répondre, si vous vous engagez à dire à qui voudra l'entendre que, jusqu'au bout, nous avons fait notre devoir. " |
|
Napoléon III envoie le général Frossard au château de Miramar (au nord-ouest de Trieste, en Italie) afin d'aller chercher Maximilien de Habsbourg et sa femme, Charlotte de Belgique, réputée comme l'une des plus belles princesses de son temps, pour les placer sur le trône Mexicain.
L'archiduc Maximilien de Habsbourg (1832-1867) et sa femme, Charlotte
Malgré ses très naturelles hésitations, Maximilien accepte, et débarque le 28 mai 1864 à Veracruz. Le 10 juin, il entre à Mexico.
Entrée de l'armée française à Mexico (10
juin 1863), La guérilla
De nombreux partisans de Benito Juarez se révoltent contre l'occupation et se regroupent dans la ville d'Oaxaca.
Le général Bazaine mène les opérations militaires afin de prendre la ville. Le siège dure quelques mois, puis c'est la chute en février 1865.
Les rebelles rejoignent les guérilleros du Nord dans leur fuite.
François Achille Bazaine, maréchal de France (1811-1888).
L'armée française montre ses premiers signes de faiblesse. Elle n'a pas de chevaux, contrairement aux guérilleros et a du mal à lutter contre leur
stratégie au combat. De plus, la guerre de Sécession aux Etats-Unis vient de prendre fin : les partisans de Benito Juarez se tournent vers
Washington qui réclame le départ de Maximilien, le retrait français et masse des troupes aux frontières.
Attaque d’un convoi français par la guérilla mexicaine. La fin de l'aventure
La situation en Europe commence aussi à devenir inquiétante : la montée en puissance de la Prusse, sous l'influence de Bismarck, menace la France.
Napoléon III décide alors de retirer progressivement ses troupes du pays et abandonne les villes conquises. Le dernier navire français quitte les
rives mexicaines en février 1867.
Les libéraux et les républicains peuvent alors librement s'opposer à l'empereur Maximilien, resté sur place après l'abandon des troupes françaises. Ce dernier croit pouvoir conserver son trône et envoie sa femme demander de l'aide aux souverains européens. Mais aucun arrangement n'aboutit, et Charlotte, souffrant de crises de folies, ne peut retourner au Mexique. |
|
Ferdinand Maximilien Joseph de Habsbourg, |
Marie Charlotte Amélie de Belgique, |
|
Le 15 mai 1867, l'empereur Maximilien est pris par les troupes juaristes et emprisonné. Il est jugé par une cour de justice qui se tient dans le théâtre de la ville et condamné à mort. Il est fusillé à Querétaro sur ordre de Juarez " pour l'exemple ", le 19 juin 1867.
L'Exécution de Maximilien,
Marchant vers l'exécution, Maximilien tend à l'abbé sa montre qui renferme le portrait de sa femme, et dit :
" Envoyez ce souvenir en Europe à ma bien chère femme, si elle vit, dites-lui que mes yeux se fermeront avec son image que j'emporte là-haut ".
Puis il s'exclame : " Je pardonne à tous, que tous me pardonnent. Que mon sang prêt à couler soit répandu pour le bien du pays. Vive le Mexique !
Vive l'indépendance ! "
|